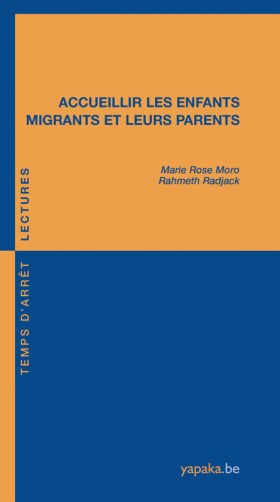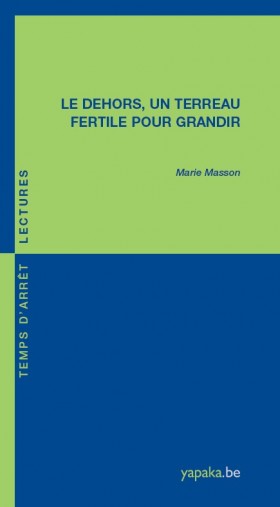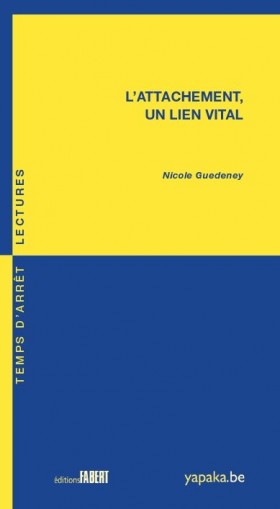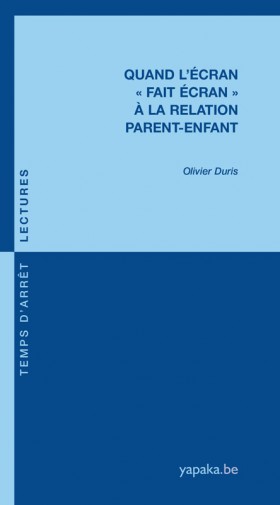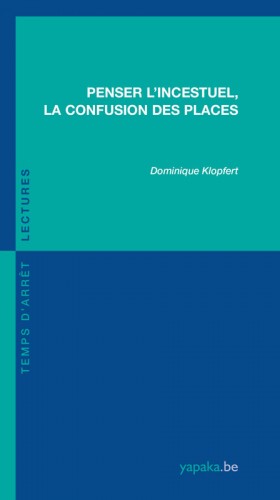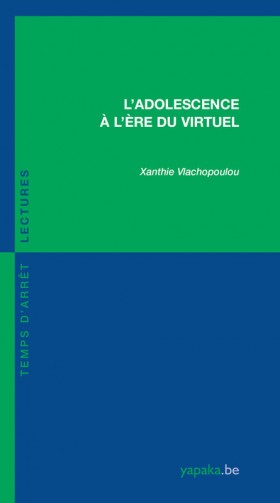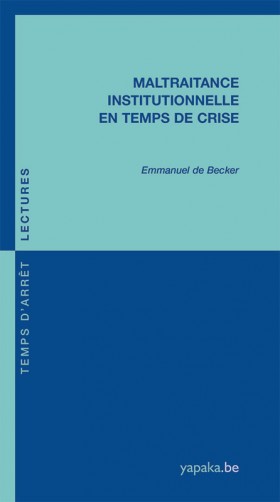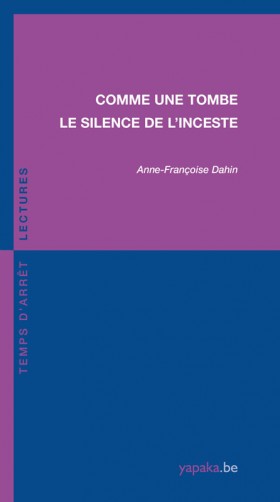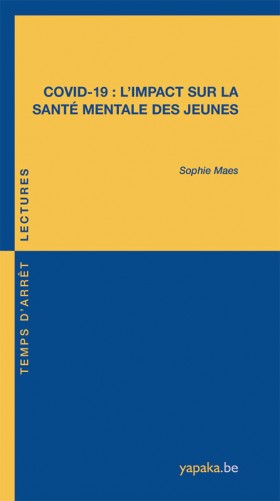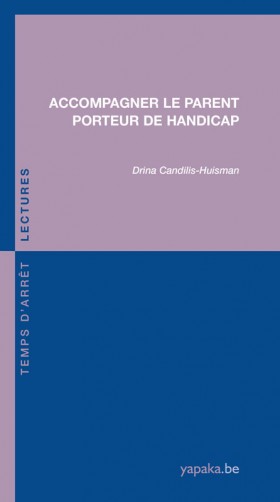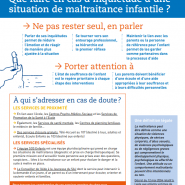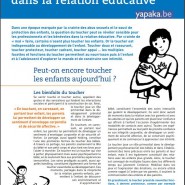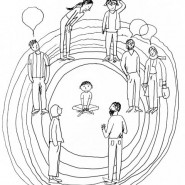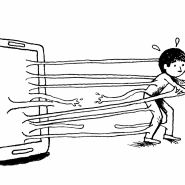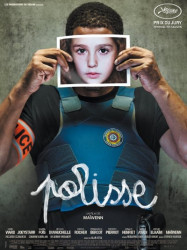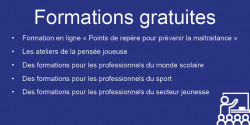Les réactions des proches
Le silence dans l’inceste perdure par le pressentiment que dire provoquera le pire. Or, il arrive que le secret éclate au grand jour, de manière involontaire, soudaine, fortuite, brutale. Et souvent, par le fait d’un tiers : un confident dévoile, un témoin surprend, un proche a compris… Nombre de récits de vie, de témoignages montrent que la réalité peut venir confirmer la prémonition et l’ensemble des peurs anticipatives autour des réactions à la divulgation. Ce peut tout d’abord être le cas de l’absence totale de réponse de l’entourage. Dans La Fabrique des pervers, Sophie Chauveau décrit le « silence de mort » qui accueille le livret qu’a adressé sa cousine, Béatrice, à sa famille, décrivant l’inceste subi. « Tu crèveras avec ton secret dans ta tombe », pense un fils à la suite de la révélation fortuite de l’inceste à un proche de la famille, qui reste sans aucun écho. Dans Féroces, Robert Goolrick rapporte comment mère, ayant surpris l’acte d’inceste – et ayant permis ainsi d’y mettre un terme –, n’adresse pourtant aucune parole à son fils au moment même, ni aucun réconfort, ni même jamais par après. De même, Christine Angot rapporte la réaction de sa mère à qui l’inceste vient d’être révélé : « le soir, elle ne m’a rien dit. On a dîné. On a regardé la télévision. On s’est couchées » (p. 88). Faire « comme si de rien n’était » peut s’avérer être la réaction dite « humaine » la plus immédiate et fréquente, du fait du caractère innommable, mais aussi irreprésentable de l’acte révélé : c’est la portée du « hors de » qui fait ici son œuvre à travers les formes de déni d’existence, de réalité, de gravité. Aussitôt révélée, la vérité est expulsée hors entendement, néantisée une nouvelle fois. Auprès de la personne qui a subi, un tel silence de mort après la révélation peut paradoxalement résonner comme une véritable déflagration ; celle d’un renvoi à la solitude intrinsèque face à l’anéantissement subi. Cela peut entraîner sur le long terme l’extrême difficulté, voire l’incapacité, à s’investir dorénavant soi-même, au regard du désinvestissement éprouvé et de l’abandon redoublé. L’étiolement et le sentiment de mort interne peuvent envahir l’espace psychique et ouvrir la porte à la négligence de soi, au manque de soin, voire à la maltraitance envers soi-même. Menacer, mettre en doute, culpabiliser, disqualifier, accuser sont d’autres réactions fréquentes en réponse à la révélation. Robert Goolrick rapporte, dans son livre autobiographique Féroces, les paroles de sa grand-mère à qui il confia l’acte incestueux qu’il subit de son père, à un âge très précoce : « Ne répète jamais cette histoire à qui que ce soit d’autre. Si tu répètes cette histoire à quelqu’un, il arrivera des choses terribles. Quelque chose de terrible arrivera à notre famille. » Dans le film Elle ne pleure pas, elle chante, la mère dit à sa fille qui révèle les actes incestueux subis par le père : « Tu me dégoûtes, tu me dégoûtes vraiment. » Des réponses telles que « tu l’as imaginé, suscité, souhaité… » sont fréquentes. Le bannissement, qui illustre l’adage : « donne un cheval à qui dit la vérité, il en aura besoin pour s’enfuir », consiste à exclure du cercle familial celui qui peut en compromettre l’homéostasie, attirer sur lui l’opprobre, la culpabilité et l’indignité. Dans le même sens, Goolrick témoigne comment il s’est progressivement senti devenir l’enfant dangereux aux yeux de sa famille. « Elle savait. Elle avait vu. Il savait. Il l’avait fait. Ma grand-mère savait. [...]. Et moi je savais, j’étais assez grand pour parler et je pouvais raconter. Aussi avaient ils peur de moi. Et ils prirent leur revanche plus tard à travers des scènes de haine extraordinaires. [...] On me dit que mon père me criait dessus en public, on me dit qu’il me traitait de porc, on me dit qu’il hurlait que j’avais détruit tout ce qu’il y avait de bien » (p. 207). C’est que la révélation peut mettre en cause d’autres membres de la famille, ceux qui ont fermé les yeux, gardé le silence sur ce qu’ils savaient, autorisé tacitement. Souvent, en effet, l’inceste n’est rendu possible que par une certaine forme de complicité de tout un entourage, dont, en premier, familial. Il s’agit de toute une dynamique relationnelle dysfonctionnelle qu’il faut considérer à l’œuvre. Mais, également, la révélation peut lever le voile sur ceux qui s’avèrent avoir participé activement aux actes transgressifs. Dans son livre-témoignage Ce n’était pas de l’amour, Betty Mannechez raconte l’histoire d’une longue maltraitance familiale, mais aussi d’inceste, dont elle et sa sœur aînée ont été victimes depuis un très jeune âge. À l’âge de 18 ans, elle fugue et porte plainte. Le père est incarcéré. Mais, bien qu’elle n’ait en aucun cas accusé sa mère, celle-ci va être également arrêtée par les enquêteurs qui ont pu mettre en évidence sa participation active. Tous deux seront jugés devant la cour d’assises. Betty Mannechez énonce, dans les premières pages de son livre : « C’est l’union des deux perversions de mes parents qui a créé notre enfer. » Enfin, la révélation peut également susciter des passages à l’acte violents. Un membre de la famille, en apprenant les faits, menace de tuer l’auteur de l’inceste. Des réactions suicidaires – voire des suicides aboutis – sont déclenchées après la révélation : il peut s’agir de l’autre parent, par culpabilité de n’avoir pas pu protéger ; de la victime elle-même qui ne peut supporter les réactions à la révélation, la culpabilité d’avoir parlé ou la honte d’apparaître dorénavant en tant que victime ; mais aussi de l’auteur qui trouve par là le moyen de se substituer aux questions, aux reproches, à la justice, à la culpabilité, ou comme expression ultime de sa toute-puissance. Le meurtre peut également conclure une histoire d’inceste. C’est la fin tragique que rapporte Betty Mannechez dans son livre : le père, condamné par deux fois pour inceste sur ses deux filles, finit néanmoins par assassiner l’aînée avec laquelle il vivait maritalement depuis qu’elle avait atteint sa majorité et dont il a eu un enfant. Ayant décidé de le quitter, elle était parvenue à se substituer à son emprise et s’était éloignée du domicile conjugal. Le père l’ayant retrouvée, la tue ainsi que l’homme qui l’hébergeait et retourne l’arme contre lui. Sauvé de ce geste suicidaire, il sera jugé pour double assassinat en 2018. Il décède d’une crise cardiaque le lendemain du verdict. Heureusement, d’autres récits viennent montrer la pertinence de certaines interventions qui arrivent au moment opportun et se révèlent justes et opérantes. Goolrick raconte que c’est une amie qui lui permit de mettre fin à l’automutilation et d’entreprendre un séjour à l’hôpital. Alors qu’elle prend de ses nouvelles par téléphone, il se surprend à lui dire, dans le détail, ce qui lui arrive. Et elle de rétorquer : « Laisse-moi faire. Contente-toi de venir. Je te ferai hospitaliser ici. On s’occupera bien de toi. Je connais le chef de service en psychiatrie… » Goolrick rajoute : « sa diction, ralentie par le whisky, était chaleureuse et réconfortante, comme l’imposition des mains » (p. 139). Imposition, sans imposer par un toucher réel, tout en s’interposant néanmoins, avec bienveillance, dans ce qui est destructeur et ne trouve pas d’appui pour s’arrêter. À l’inverse des révélations soudaines, quand rien n’est dévoilé, le silence qui perdure, de façon à la fois paradoxale et kaléidoscopique, va induire une position invivable entre un interdit absolu de parler et un impératif intérieur à signifier, pour exister. Une lutte interne constante s’engage entre différents mouvements pulsionnels qui s’opposent, s’annulent, se contredisent, se succèdent, s’allient et se délient. Christine Angot : « j’avais deux méthodes de survie, avec deux objectifs opposés. J’étais partagée en deux. Parler, briser le silence. Pour ça, il fallait voir les choses. Les savoir. Les faire exister dans sa tête. Se les représenter mentalement. Supporter les images. Vivre avec elles. Trouver les mots qui leur correspondaient. Les exprimer. Se taire. Ça permettait de ne pas avoir d’images, dans la tête, continuer à faire semblant. De ne pas savoir vraiment. De ne pas avoir peur, de ne pas donner corps à l’inquiétude, de ne pas donner réalité à l’impression d’avoir une vie gâchée » (Le Voyage dans l’Est, p. 77). Ce conflit interne épuise et engendre des comportements en apparence insensés qui ne laissent percevoir ni entendement ni logique. La personne qui en est la proie s’appréhende elle-même le plus souvent comme atteinte de folie, et ce, non sans angoisse, qu’elle ne peut par ailleurs ni communiquer ni adresser. Et telle est aussi l’impression qu’elle peut parfois donner aux autres, les proches qui l’entourent, mais également aux aidants. Tout le monde peut se retrouver dérouté, désarçonné.
In AF Dahin, in Comme une tombe, le silence de l'inceste, 33-37, février 2022